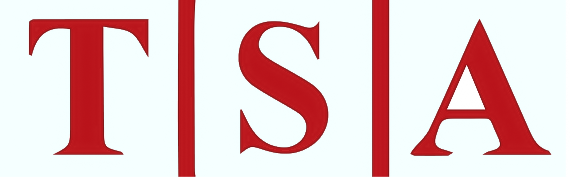CONTRIBUTION. Partout en Algérie les consommateurs s’alarment : le prix du kilogramme de poulet atteint des sommets.
La cause : la flambée des prix du maïs et du soja sur le marché international suite aux achats massifs de la Chine qui tente de se prémunir contre d’éventuelles ruptures d’approvisionnements liés à la pandémie du Covid-19.
Les éleveurs et les ménages à faible revenu se trouvent fortement impactés. Du côté des pouvoirs publics, les marges de manœuvres sont réduites en cette période de Hirak et de chute des revenus pétroliers.
Côté consommateurs, le mythe d’une Algérie ancien grenier de Rome est tenace, et dans un pays à dominante désertique, chacun estime avoir droit au mode de consommation alimentaire européen. Ce modèle qui donne la part belle aux produits animaux au dépend des protéines d’origines végétales.
Alger, le poulet à 430 dinars le kilo
Sur les réseaux sociaux, fleurissent les photos de poulets trônant sur des balances avec l’affichage du prix correspondant. Du jamais vu. « Comment voulez-vous que les pauvres s’en sortent« , demande un consommateur sur la chaîne de télévision Ennahar. Le prix du kilo de poulet correspond à 43 baguettes de pain.
De leur côté, les éleveurs déclarent travailler à perte. Le prix du soja a atteint 5700 DA le quintal contre 2600 DA en octobre dernier. Quant au maïs, il a atteint 11.500 DA le quintal après avoir été à 4.800 DA. L’interprofession réclame pour sa part la suppression de la TVA sur le maïs et le soja. Autant mettre un emplâtre sur une jambe de bois.
À cette hausse du poste alimentation, il faut ajouter les effets de la crise du Covid-19. De nombreux éleveurs ont temporairement gelé leur activité de crainte de ne pouvoir vendre leur production, comme l’an passé lors des restrictions à la circulation des marchandises entre régions.
Une consommation de viande qui a triplé en 50 ans
Au sortir des années soixante, face au phénomène chronique de sous-nutrition touchant la population, les conseillers économiques soufflent à l’oreille du président Boumédiène une solution miracle : développer l’élevage industriel des volailles.
Avantage : une totale indépendance vis à vis des aléas climatiques puisque les animaux sont élevés dans d’immenses hangars. Pour nourrir les volatiles, il suffirait de leur donner un mélange de maïs et de soja. Le succès est immédiat.
Outre le progressif développement de l’élevage du mouton, œufs et viande de poulet commencent à inonder le marché local. Comme l’indique l’économiste Omar Bessaoud « Les calories consommées par habitant et par jour ont plus que doublé entre les périodes 1963-1967 et la période 2009-2013« .
Quant aux apports des produits animaux dans la ration, « ils ont augmenté en comparaison des années 1960, les protéines animales constituant en 2009-2013, 27 % des protéines totales, contre 17 % dans les années 1963-1967« .
Aujourd’hui, les consommateurs mangent 3 fois plus de viande qu’il y a 50 ans. Or, la population s’élève à 42 millions d’habitants et on compte près d’un million de naissances par an. La demande en viande ne cesse de croître.
L’échec prévisible du modèle maïs-soja
L’élevage industriel des volailles est donc basé sur un modèle alimentaire faisant essentiellement appel au couple maïs-tourteaux de soja. Or, étant donné la nature semi-désertique du pays, ces deux matières premières ne peuvent pas être produites localement.
Elles ont donc dû être importées. Insignifiantes au début, les importations n’ont cessé de croître. Elles atteignent annuellement plusieurs centaines de millions de dollars.
Très tôt, de nombreux universitaires ont vainement tiré la sonnette d’alarme. Ils ont dénoncé l’utilisation exclusive du couple maïs-soja et ont proposé la mobilisation d’autres ressources locales : orge, triticale, féverole et sous-produits des industries agro-alimentaires.
Mais jusque-là, l’aisance financière liée à la rente pétrolière a permis de reporter au lendemain les ajustements nécessaires. Il faut également compter avec l’arrivée sur le marché de la fabrication de l’aliment de volailles de puissants groupes privés installés sur le marché lucratif de l’importation. L’échec actuel de la filière avicole locale était prévisible.
Il est ainsi symptomatique que les fabricants publics et privés d’aliments du bétail n’aient jamais eu l’obligation d’incorporer progressivement des produits locaux.
Une telle démarche accompagnée d’un suivi matériel, technique et financier des agriculteurs aurait pu faire décoller une production locale. Pour le directeur général de l’Office national des aliments du bétail (Onab) la solution passe par la culture locale du maïs.
Récemment, il a annoncé la mise en culture prochaine de 9.000 hectares de maïs. Dans le Sud, avec irrigation continue et de fortes subventions, les rendements obtenus sous pivot atteignent 80 quintaux par hectare. Or, les besoins annuels sont colossaux et sont estimés à 4 millions de tonnes de maïs.
Plus grave, cette culture demande un arrosage massif alors que nombre de barrages sont à sec et que les nappes phréatiques voient leur niveau dramatiquement baisser. Déjà, les villes du littoral doivent recourir à un coûteux dessalement de l’eau de mer sans même que le prix réel du mètre cube d’eau ne soit répercuté sur la facture d’eau des consommateurs.
Forts du nombre d’emplois que leur activité génère dans la filière, les fabricants privés d’aliments du bétail constituent aujourd’hui une force de pression considérable vis à vis des pouvoirs publics.
Avec les propriétaires de couvoirs industriels, ces fabricants font vivre tout un monde de petits éleveurs aux installations rudimentaires parfois composées de simples garages ou de serres réaménagées en poulaillers. En effet, au million de chômeurs que compte le pays, il faut tenir compte des 300 000 jeunes qui arrivent annuellement sur le marché de l’emploi.
La steppe, le pays du mouton
Avec près de 30 millions d’hectares d’étendues steppiques, l’Algérie est considérée comme le pays du mouton. Ce type d’élevage contribue largement à l’alimentation de la population.
Mais dans son état de dégradation actuelle, la steppe ne peut supporter que 4 millions de têtes d’ovins. En effet, il s’agit de tenir compte des capacités de régénération naturelle des parcours.
Or, le cheptel qui était de 9 millions de têtes en 1963 est passé à 16 millions en 1991 et atteint aujourd’hui 25 millions. À elle seule, la région de Djelfa en compte 3 millions.
Cette augmentation n’a été possible que grâce à des importations massives d’orge. Face à un chômage rural endémique l’élevage du mouton reste souvent la seule source de revenu possible dans les zones rurales d’autant plus que la demande en viande des villes est forte.
Mais le surpâturage provoque une désertification dont les effets les plus manifestes sont l’apparition de dunes de sable, là où auparavant se trouvaient des touffes d’alfa. Le réchauffement climatique rend également plus aléatoire les pluies salvatrices qui faisaient auparavant reverdir les pâturages après la canicule estivale.
Une difficile transition alimentaire
Dès le milieu des années 1970, des universitaires ont dénoncé le recours aux seules protéines animales au détriment des protéines végétales telles les légumes secs.
En effet, de tout temps, le traditionnel couscous aux pois chiche ou aux fèves a fourni une ration équilibrée. Les acides aminés dits essentiels contenus dans les légumes secs complétaient admirablement ceux contenus dans la semoule de blé dur. Puis les cultures de blé et de pois chiche sont bien moins gourmandes en eau que celle de maïs et de soja ; de ce fait leur production locale est possible. Mais rien n’y fait.
Il est vrai qu’il s’agit également de tenir compte de la transition alimentaire en cours dans bon nombre de pays émergents. Si nombre de sociétés se sont surtout nourries à base de riz et de blé, l’augmentation du niveau de vie s’est traduite par une augmentation de la consommation de viande.
Si en Chine, le bol de riz est aujourd’hui accompagné de viande de porc, en Algérie le couscous est aujourd’hui accompagné de viande de mouton ou de poulet dans le cas des revenus les plus faibles, délaissant les traditionnels pois chiche pourtant source traditionnelles de protéines.
Si dans les pays européens se dessine une nouvelle transition alimentaire avec un progressif abandon de la viande et le retour dans les rations alimentaires de protéines d’origine végétale (lentilles, pois-chiche, soja), pour les consommateurs algériens il semble inconcevable de ne pas accéder à la modernité que constituent la viande, le fromage et les autres produits laitiers.
Assurer des substituts protéiques aux consommateurs
Parallèlement aux tentatives de sauvetage de la filière, l’alternative pourrait être d’offrir au consommateur local une ration alimentaire contenant une part plus importante de protéines végétales.
Pour le budget de l’État, il serait plus intéressant de diriger les cargaisons de tourteaux de soja accostant au port d’Alger, vers des usines de produits alimentaires que de les destiner aux élevages de volailles.
En effet, les décideurs ont oublié que les estomacs humains peuvent consommer du soja. Il suffit pour cela d’aller faire un tour en Asie. Mais le problème est que l’industrie agro-alimentaire locale et les consommateurs n’y ont pas été préparés.
Pourtant, il serait possible d’inclure du soja texturé dans la charcuterie halal locale : merguez, « cashir« , tripes… Mais également dans différents plats cuisinés ou aliments simples : pâtes alimentaires, biscuits et même produits laitiers tels que lait, fromage, yaourts, crèmes desserts dont raffolent les consommateurs locaux.
Outre le soja, il est également possible d’utiliser des extraits de protéines provenant de pois chiche ou de pois jaunes comme le proposent respectivement la start-up InnovoPro ou la société Roquette qui misent sur la Food Tech.
Ces entreprises misent sur le « cracking » et ont déposé des brevets concernant les procédés permettant de séparer par voie sèche ou humide, l’amidon des protéines de la graine.
Aujourd’hui, la société Roquette exploite des milliers d’hectares de pois jaune en France et au Canada. Cette société est spécialisée dans l’extraction de l’amidon des pommes de terre de fécule. Afin de compléter cette activité saisonnière, Roquette développe un procédé pour isoler par voie humide, les protéines du pois de l’amidon contenu dans la graine.
Aujourd’hui cette entreprise met sur le marché des concentrés de protéines végétales utilisés dans les industries agro-alimentaires. Avec une presse-extrudeuse et des extraits de protéines, il est aujourd’hui possible de produire des substituts végétaux de viande dont du blanc de poulet, notamment utilisés afin de produire des Nuggets.
De son côté, la société française Les Graineurs (ex-Nutrinat) met au point des farines de graines de blé dur et légumineuses germées. Une germination de 48 à 72 heures permet en effet une meilleure digestibilité des protéines de ces graines. C’est l’ancien rugbyman français, Laurent Spanghero qui est le premier à avoir investi dans cette voie. Il aime à dire que 100 grammes des pâtes alimentaires qui sortent de ses ateliers contiennent autant de protéines que 100 grammes de viande.
La Food Tech connue du ministre délégué aux start-up
Mais investisseurs, décideurs et universitaires ont-ils seulement entendu parler de Food-Tech ou simplement ont-ils eu l’idée de feuilleter les revues spécialisées de l’industrie agro-alimentaire ?
Pour réduire le niveau des importations, les décideurs seraient bien inspirés de laisser entrer et mettre en kiosque les titres de la presse spécialisée tels l’Usine Nouvelle, LSA, … Mais dans un pays où n’existe ni tradition d’un syndicalisme agricole indépendant ou ni tradition d’une participation, même minime, des agriculteurs à la gestion des budgets, le centralisme administratif reste très prégnant.
Alors que dans un pays à dominante désertique, les pouvoirs publics s’échinent à nourrir des animaux avec du maïs, soja, orge et du son, ne faudrait-il pas penser à utiliser ces matières nobles dans l’alimentation humaine sans les faire passer auparavant par le tube digestif des animaux ?
Un espoir. En février dernier, Yacine El-Mahdi Oualid, le jeune ministre délégué chargé des start-up a pris l’initiative d’une réunion avec les ministres de l’Agriculture et celui de la Pêche. Il a évoqué un dossier jusque-là jamais abordé : celui de la Food Tech.
*Ingénieur agronome
Important : Les tribunes publiées sur TSA ont pour but de permettre aux lecteurs de participer au débat. Elles ne reflètent pas la position de la rédaction de notre média.