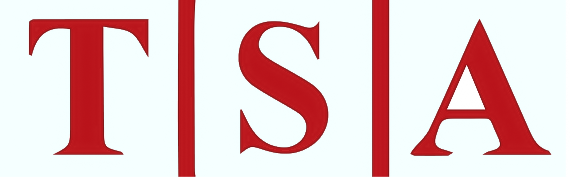Une mission d’exploration de la planète Mercure doit être lancée ce vendredi 19 octobre de la base spatiale Kourou (en Guyane). Baptisée BepiColombo, la mission spatiale est le fruit de collaboration entre l’Agence spatiale européenne ESA et l’agence spatiale japonaise JAXA.
La mission est constituée de deux satellites qui vont tourner autour de Mercure, la planète la plus proche du soleil. Le satellite MPO sous la responsabilité de l’ESA aura une orbite basse et va se focaliser sur la planète elle-même, la composition de sa surface et de son atmosphère. L’autre satellite MMO, sous la responsabilité de la JAXA, va regarder l’environnement magnétisé (ou magnétosphère) de Mercure et son interaction avec le vent solaire.
Sur ce satellite MMO sont embarqués plusieurs types d’instruments dont un fluxmètre, un capteur magnétique qui mesure les fluctuations (ou variations) du champ magnétique. Cet instrument est actuellement sous la responsabilité de Fouad Sahraoui, un astrophysicien de 43 ans d’origine algérienne, qui a étudié en Algérie avant de quitter le pays il y a vingt ans, pour devenir actuellement directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Entretien.
Quel a été votre parcours ?
Je suis originaire d’un village à Bouira qui s’appelle Raffour. J’ai étudié deux ans à l’université de Bejaïa puis deux ans à l’USTHB (Bab Ezzouar) où j’ai obtenu un DES en physique du rayonnement. J’ai quitté l’Algérie en 1998 pour m’installer en France, où j’ai fait mon DEA en physique des plasmas à l’université de Paris Pierre et Marie Curie puis une thèse sur les plasmas spatiaux. J’ai intégré le CNRS en 2005 après deux années de recherche post-doctorat au CNES (Agence spatiale française). J’ai travaillé ensuite quelques années aux Etats-Unis, à la Nasa (centre GSFC près de Washington DC), avant de revenir en France. Je travaille aujourd’hui dans le laboratoire de physique des plasmas (LPP) à l’école polytechnique près de Paris.
Pourquoi avez-vous quitté l’Algérie ?
C’était toujours mon rêve de faire ce que je fais actuellement, de faire de la recherche scientifique dans le domaine de l’astrophysique. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles à faire en Algérie, c’est un domaine très pointu. C’est ça qui m’a motivé à partir pour tenter une expérience à l’étranger. En Algérie, les professeurs nous disaient que si on voulait faire une carrière brillante, il faut partir. Notamment dans certains domaines où les moyens sur place n’étaient pas disponibles. L’astrophysique nécessite une technologie de pointe, un savoir-faire important, des moyens humains et matériels très importants qui ne sont pas disponibles en Algérie.
En quoi consiste le domaine dans lequel vous travaillez ?
Je travaille sur la physique des plasmas. Pour faire simple, le plasma est le quatrième état de la matière, avec les états solide, liquide et gazeux. On pense qu’il constitue 90% de la matière visible de l’Univers. Si on continue à chauffer un gaz, il devient ionisé, ce qui génère à la fois de l’électricité et du magnétisme.
Dans les plasmas, on peut distinguer au moins trois grands : les plasmas astrophysiques (tout ce qu’on trouve autour de notre planète et dans les étoiles et galaxies lointaines), les plasmas de laboratoire dédiés aux applications technologiques (comme par exemple le néon ou les écrans plasmas que vous avez dans votre maison), et les plasmas de fusion (confiner le plasma dans des machines appelées Tokamaks pour créer l’énergie du futur).
Dans lequel de ces domaines êtes-vous spécialisé ?
Je me spécialise plutôt dans les plasmas astrophysiques, ceux qu’on observe dans l’espace. Ca va des hautes couches de notre atmosphère jusqu’aux environnements d’autres planètes ou encore le plasma du soleil lui-même. J’étudie l’interaction du vent solaire avec les planètes du système solaire notamment celles qui ont un champ magnétique propre. C’est le cas de notre Terre et c’est aussi le cas de Mercure, Jupiter ou Saturne.
En quoi consiste votre travail quotidien ?
Mon travail quotidien consiste à travailler sur ces thématiques en faisant des modèles théoriques ou mathématiques sur ces interactions que je confronte ensuite aux données des missions spatiales. Les satellites envoyés dans l’espace font des mesures des phénomènes qu’on veut observer et étudier, ils nous renvoient les données et on les analyse
Ces dernières années je m’implique également dans la définition des missions spatiales futures et dans le développement de l’instrumentation de pointe afin de pouvoir l’embarquer sur ces missions futures. On prépare les nouvelles missions sur des échelles de plusieurs années avant qu’elles ne soient lancées dans l’espace pour repousser les limites de la connaissance.
Etait-il possible pour vous en Algérie de faire une spécialité en physique des plasmas ?
Il était en effet possible à l’époque de faire un magistère en physique de plasmas en Algérie. Mais les moyens étaient trop limités pour faire de la recherche de pointe sur place, notamment dans un domaine comme l’astrophysique. C’était très marginal.
Développer un programme ou une industrie spatiale nécessite des moyens très difficiles à avoir en Algérie. Envoyer un satellite dans l’espace nécessite d’avoir des moyens humains et techniques très pointus. Il faut avoir une expertise dans beaucoup de domaines. À ce niveau-là, il n’y a qu’une poignée de pays au niveau international qui ont réussi à acquérir de telles compétences et développer de grands programmes spatiaux.
Était-il possible pour l’Algérie de vous retenir ?
C’est une question difficile. On ne quitte pas son pays de gaieté de cœur. On peut partir ailleurs pour découvrir d’autres horizons, mais toujours avec une volonté de revenir pour pouvoir faire quelque chose. La difficulté est évidemment toujours la même en Algérie. C’est le manque de moyens dans la recherche, ce sont les blocages. Ce n’est pas le manque de moyens vu que l’Algérie en dispose, mais il faut qu’elle investisse beaucoup plus dans la formation et dans la recherche scientifique à tous les niveaux.
Chaque pays doit développer son programme de recherche en fonction de ses besoins. Ça peut être des besoins économiques, puisqu’on ne peut pas peut-être investir dans tous les domaines. Mais force est de constater que les chercheurs algériens partent à l’étranger pas qu’en astrophysique mais dans quasiment tous les domaines.
En quoi consiste la mission d’exploration de Mercure ?
La mission s’appelle BepiColombo. Elle est constituée de deux satellites, un qu’on appelle MPO (Mercury Planetary Orbiter). Il va orbiter très près de la planète et regarder plus la planète elle-même, la composition de sa surface et de son atmosphère. C’est un satellite qui est sous la responsabilité de l’ESA. Il y a un autre satellite qui s’appelle MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter, renommé MIO très récemment) sous la responsabilité de la JAXA, équipé d’un ensemble complet d’instruments dédiés aux mesures in-situ du plasma de la planète et son interaction avec le vent solaire.
Quel est votre rôle dans cette mission ?
Je suis actuellement le responsable scientifique de l’instrument DBSC (Dual-Band Search Coil magnetometer) embarqué à bord du satellite japonais MMO et dédié aux mesures des ondes électromagnétiques dans l’environnement plasma de Mercure. Ses mesures seront complétées par celles d’autres instruments comme les antennes électriques ou les analyseurs plasma (qui mesurent sa composition, sa densité, vitesse, température…). C’est grâce à ces mesures qu’on comprend mieux la dynamique de la planète et son interaction avec notre étoile, le soleil.
Quel est le coût de la mission ?
Ce genre de missions coûte au-delà d’un milliard d’euros, voire même deux milliards. Ce sont des missions qui se préparent sur plusieurs années (de dix à vingt ans). C’est de grands défis scientifiques et techniques pour pouvoir monter ce genre de missions. La mission sera lancée le 19 octobre 2018, mais son insertion finale dans l’orbite n’interviendra autour de Mercure qu’en décembre 2025, après sept ans de croisière.
En quoi cette mission est importante ?
L’être humain n’est rien sans cette volonté de découvrir autre chose, le nouveau. On est en train d’explorer des régions de l’espace où on n’a jamais été avant. Dans le cas de Mercure ça a déjà été visité par la mission américaine Messenger mais avec une instrumentation plus réduite. Là on ira avec une nouvelle instrumentation plus complète et avec deux satellites complémentaires, et donc on découvrira de nouveaux phénomènes physiques.
Quelle est votre réponse à ceux qui disent qu’il y a d’autres priorités ?
J’assume pleinement l’idée de dépenser de l’argent public pour la connaissance scientifique. Souvent on nous interpelle, et c’est une question légitime, en nous demandant s’il est judicieux d’envoyer deux milliards d’euros dans l’espace. Pour moi, rien que pour la connaissance ça vaut la peine parce que si on attend de régler tous les problèmes on ne va rien apprendre sur l’humanité et sur l’univers.
Au-delà de ce point, il y a clairement des retombées directes. Envoyer de tels instruments dans l’espace nécessite une technologie de pointe. Il y a beaucoup de technologies à développer parce qu’il faut notamment travailler sur la miniaturisation car envoyer quelque chose de lourd dans l’espace coûte très cher, donc on miniaturise beaucoup. On développe également une électronique de pointe qui résiste à de fortes radiations et amplitudes thermiques (-200°C et + 200°C ou plus !) qu’on rencontre dans l’espace, c’est un environnement très hostile.
Il faut savoir que dans la recherche spatiale on travaille beaucoup avec les entreprises privées. Quand on injecte un à deux milliards dans un tel projet, ce coût inclut le travail de sous-traitance qu’on fait dans les entreprises privées. Ceci génère donc du savoir-faire, du transfert de technologie des laboratoires de recherche vers l’industrie et du développement d’un tissu économique et industriel.
Avez-vous comme projet d’éventuellement revenir en Algérie ?
A titre personnel, je n’y crois pas trop à cette idée de retour. Je n’envisage pas cela comme aller simple ou un retour simple, mais plutôt en termes d’interaction. En Algérie ce qui me parait envisageable c’est de tirer profit de celles et ceux qui sont à l’étranger. Pas de les faire revenir, parce qu’évidemment on ne peut pas abandonner le type de recherche qu’on fait ou les moyens dont on dispose ici pour repartir de zéro. Par contre, on peut profiter de ce savoir-faire pour lancer des choses sur place, un transfert de technologie et d’idées scientifiques. Je pense que c’est tout à fait envisageable.
Comment vivez-vous le déracinement qui touche ceux qui partent ?
L’émigration a certes ses avantages, mais il y a clairement une part de déracinement dedans. Quand on quitte l’Algérie et sa famille les débuts sont toujours difficiles. Peut-être que maintenant par rapport à il y a quelques années, les moyens de transport et les moyens de communication rendent l’exil beaucoup plus supportable. On peut appeler ses parents avec Skype, on peut les voir. Maintenant il y a des portables, il y a internet… Ca allège un peu le fardeau de cet exil.