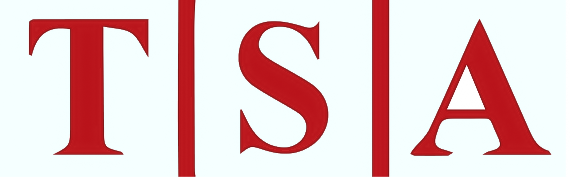Arezki Ait Larbi est un acteur de premier plan du printemps amazigh d’avril 1980. Il a été un des 24 militants arrêtés le 20 avril et déférés devant la Cour de sûreté de l’État. Il sera libéré avec ses compagnons vers la fin juin, après une mobilisation historique de toute la Kabylie.
Également membre fondateur de la première Ligue algérienne des droits de l’Homme (LADH), il continue à militer depuis pour tamazight, la démocratie et les droits de l’Homme.
À l’occasion du 38e anniversaire du Printemps amazigh, M. Ait Larbi a accordé une interview à TSA, dans laquelle il revient sur la symbolique de cette date, ses conséquences et sur sa vision de la situation de la revendication amazighe.
Nous célébrons le 38e anniversaire du Printemps berbère, un événement dans lequel vous avez été un acteur de premier plan. Quel bilan en faites-vous, presque 40 ans après et que représente cette date à vos yeux ?
Une année après le Printemps berbère de 1980, la journée du 20 avril a été commémorée comme journée de lutte contre la répression, avant de se perpétuer comme un rappel annuel des revendications du mouvement.
Faut-il rappeler que le Printemps berbère ne se résume pas à cette journée du 20 avril. Le mouvement avait commencé le 10 mars 1980, avec la première manifestation de rue de la communauté universitaire de Tizi-Ouzou qui dénonçait l’interdiction de la conférence de Mouloud Mammeri autour des « Poèmes kabyles anciens ». Très vite, la contestation s’est élargie aux lycéens, aux campus universitaires d’Alger et de Boumerdès avant d’embraser toute la Kabylie.
Avec la grève générale du 16 avril, les autorités étaient « en alerte rouge » pour reprendre l’expression de Lhadi Khédiri, le DGSN de l’époque. Dans la nuit du 19 au 20 avril, les forces de répression avaient pris d’assaut l’université de Tizi-Ouzou, l’hôpital et toutes les entreprises en grève, faisant des centaines de blessés et d’arrestations, parmi lesquels 24 seront renvoyés devant la sinistre Cour de sûreté de l’État.
S’il y a un seul motif de fierté pour les militants de cette époque, c’est de n’avoir eu à déplorer aucun mort, grâce notamment à la maturité politique des insurgés qui, malgré les brutalités policières, et la violence de la propagande officielle, ont gardé le cap pacifique du mouvement.
S’il appartient aux chercheurs, qui ont commencé à analyser le mouvement, d’en faire le bilan, je voudrais juste rappeler que la possession d’un alphabet tifinagh était, à l’époque, un délit qui pouvait mener en prison. Qu’une conférence sur la poésie kabyle était « subversive ». Que l’arabo-islamisme, idéologie officielle exclusive, rejetait dans le camp de la trahison nationale ceux qui se revendiquaient d’un autre référent identitaire, culturel ou religieux.
Si l’on peut mesurer le chemin parcouru dans la voie de l’apaisement, la partie est loin d’être gagnée pour instaurer des règles consensuelles de cohabitation pacifique dans une société plurielle.
Dans le passé, tamazight était taboue, les militants de cette cause étaient arrêtés et emprisonnés, cette langue n’avait pas droit de cité. Mais aujourd’hui, Tamazight est langue nationale et officielle ; Mouloud Mammeri, qui était dénigré par les organes de l’État en 1980, est aujourd’hui reconnu et une caravane littéraire a été organisée en son honneur par le HCA en 2017. Quelle lecture faites-vous de cette reconnaissance ? Pensez-vous qu’elle est sincère ou est-elle plutôt une tentative de banalisation et de récupération de la cause amazighe ?
Plutôt que de spéculer sur la sincérité d’une décision politique, de crier victoire ou de faire des procès d’intention, essayons de la juger sur pièces, par ses objectifs annoncés, en attendant de voir ses résultats. La technique est bien connue. À défaut de réduire une cause par la répression, qui finit toujours par montrer ses limites, on feint de l’adopter et de l’embrasser pour mieux l’étouffer.
Au lieu de réconcilier enfin le pays avec ses réalités socio-culturelles, on tente, par des mesures dont la charge symbolique est incontestable, à renvoyer leur traduction concrète à un avenir lointain. Présentées comme « révolutionnaires » par la propagande officielle, ces mesures sont déjà instrumentalisées au service d’intérêts claniques, que des clientèles en mal de 5e mandat veulent comptabiliser à la gloire du président.
En attendant d’y voir plus clair, cette » reconnaissance « apparaît déjà comme une subtile ruse de guerre pour gagner du temps, passer le gué d’une conjoncture politique délicate, avant de revenir à l’assaut avec des moyens plus « classiques ».
La loi sur l’académie amazighe et le profil des membres qui la composeront seront un indicateur fiable sur les intentions réelles du pouvoir.
Est-ce que ces acquis permettent de dire, 38 ans après le printemps amazigh, que la revendication amazighe a été satisfaite ? Que reste-t-il à faire ?
Tamazight est entrée dans la Constitution comme langue nationale et officielle « aussi ». Si cette mesure a eu le mérite incontestable de contribuer à apaiser un climat particulièrement tendu depuis le « Printemps noir » de 2001 qui avait fait 128 morts, et des centaines de blessés, dont certains handicapés à vie, elle appelle toutefois à une extrême vigilance.
Ceux qui avaient combattu tamazight comme une »création coloniale qui menace l’unité nationale » la revendiquent brusquement comme un « patrimoine qui appartient à tous les Algériens et qui ne doit pas être monopolisée par une région », comprendre la Kabylie.
Puis, on nous propose sa généralisation à tous les Algériens, lorsque l’Académie, composée d’experts, aura créée une langue standard et statué sur sa graphie. Les adversaires les plus farouches de tamazight sont déjà montés au créneau pour multiplier les obstacles, en exigeant notamment « d’écrire tamazight en langue (sic) arabe » pour reprendre la formule du président de l’Association des Oulémas Algériens. Une position partagée par tout le gotha national-islamiste, du Général Rachid Benyelles, réputé pourtant pour des interventions publiques mieux inspirées, à Mme Naïma Salhi, dont les outrances occupent les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines.
À supposer qu’elle procède d’une réelle volonté politique et qu’elle soit réalisable, une opération volontariste de « généralisation de tamazight », calquée sur l’arabisation à la hussarde dont nous commençons à mesurer les dégâts, sera contre-productive. Car, à moins de vouloir faire un nouveau croche-pied à l’histoire, on ne peut imposer une langue à ceux qui la refusent, sans en payer le prix, très cher. Ceci est valable pour tamazight, mais aussi pour l’arabe, dans ses différentes variantes: classique et dialectal.
L’État-nation centralisé hérité de la colonisation a montré ses limites. Il est temps de réfléchir à une nouvelle forme d’organisation de l’État et des territoires qui soit en phase avec les réalités socio-culturelles d’une société plurielle.Un État dans lequel chaque citoyen sera reconnu à part entière et respecté dans ses libertés, son identité, sa langue, sa culture, sa religion…
Si nous ne prenons pas le problème à bras le corps comme l’ont fait, avant nous, des pays civilisés comme le Canada, la Suisse ou la Belgique, nous risquons de sombrer dans le chaos comme le Rwanda, la Libye, l’Irak ou la Syrie, plombés par des dictatures sous-développées au nom de fictions ethniques ou religieuses.
Vous avez été acteur du Printemps amazigh de 1980, vous avez été un des 24 militants emprisonnés, aux côtés d’hommes qui continuent à influencer la scène politique et médiatique algérienne, à l’instar de Saïd Sadi ou Ferhat Mehenni. Quels rapports gardez-vous avec vos camarades d’avril 1980 ?
Dans les années 80, nous avons mené ensemble des combats qui ont contribué à infléchir la politique autoritaire du régime du parti unique. Avec « l’ouverture démocratique » en trompe-l’œil d’octobre 88, l’analyse de la « nouvelle » période historique, qui n’a été en fin de compte, qu’une mise à jour du système en vigueur depuis 1962, a abouti à d’inconciliables divergences. Notamment sur le positionnement à adopter vis-à-vis des différentes factions du pouvoir. Ce qui a amené chacun de nous à suivre sa voie, selon ses propres convictions.
Ceci dit, les divergences politiques n’empêchent pas les uns et les autres d’avoir des rapports personnels plutôt cordiaux.
Certains ont continué à militer pour tamazight, d’autres ont emprunté des chemins différents, comme Ferhat Mehenni, qui s’est engagé sur la voie du séparatisme. Que pensez-vous du parcours de Ferhat Mehenni et des mouvements indépendantistes et autonomistes kabyles ?
À propos d’autonomie, je voudrais d’abord rappeler que c’est un grand patriote, le Colonel Salah Boubnider (alias Saout Al Arab), le dernier chef de la wilaya 2 historique pendant la guerre d’indépendance, qui, le premier en 1993, avait plaidé pour la régionalisation.
En 1994, la presse avait révélé qu’un mouvement revendiquant l’autonomie de l’Oranie venait d’être lancé par d’anciens ministres écartés du sérail. Un journal avait même rapporté, sans être démenti, que dans les coulisses de ce mouvement, c’était un certain Abdelaziz Bouteflika qui tirait les ficelles. À l’époque, ces propositions d’une nouvelle organisation de l’État et des territoires plus conforme à nos réalités socio-culturelles n’avait pas soulevé le tollé qui entoure aujourd’hui Ferhat Mehenni et les autonomistes kabyles.
Revenons à votre question. Au-delà des divergences profondes dont j’ai eu à l’entretenir en toute franchise, Ferhat, qui fut le porte-drapeau de la génération 80, reste « le meilleur d’entre nous ». Lorsqu’on regarde son parcours et ses sacrifices, l’on ne peut qu’avoir du respect pour l’homme et de l’admiration pour son engagement, malgré de tragiques retours de bâton qu’il a eu à subir, parfois dans sa chair.
Alors que d’autres, parmi ceux qui lui crachent aujourd’hui au visage, s’occupaient de leur carrière dans les appareils du pouvoir et du confort de leur famille, avant de découvrir la contestation à l’âge de la retraite, Ferhat s’était dévoué corps et âme à la cause, au détriment de sa personne, de sa famille, de ses enfants. Il a été emprisonné douze fois et il a même été isolé, en juillet en 1985, dans un cachot de condamné à mort à Berrouaghia. Son fils-aîné, Améziane, a été assassiné à Paris dans des circonstances non élucidées à ce jour.
Lors du Printemps noir de 2001, et dans un climat de règlement de comptes claniques dans le sérail qui avait fait, faut-il le rappeler encore, 128 morts, des centaines de blessés dont certains handicapés à vie, Ferhat, avec d’autres militants du Printemps berbère, était sur le terrain pour tenter de limiter les dégâts, soutenir les victimes et éviter que le drame ne tourne à l’irréparable.
Sauf à rêver d’un régime à la nord-coréenne, tout mouvement politique, et le MAK ne fait pas exception, est sujet à critique. Quelle que soit l’appréciation que l’on peut avoir de ce mouvement, Ferhat et ses amis qui l’avaient créé en 2001, ont eu toutefois un double-mérite. D’abord celui de proposer un cap de réflexion, pour dépasser les désillusions engendrées par l’échec des tentatives d’élargissement de la contestation démocratique à l’échelle nationale. Ensuite, d’offrir un cadre de lutte pacifique à une jeunesse en colère, que d’aucuns poussaient vers l’aventure de la violence, notamment après la terrible répression de la manifestation du 14 juin 2001 à Alger.
Comme tous les mouvements, le MAK ne doit pas échapper à l’analyse, à la critique et au débat. Mais, comme tous les mouvements, son expression publique est légitime, tant qu’elle reste sur le terrain de la lutte pacifique. Et malgré les provocations des cagoulards avec ordre de mission chargés de polluer les débats sur les réseaux sociaux, il n’y a pas de raison pour qu’il en soit autrement.
S’il ne m’appartient pas de juger le fonctionnement interne d’un mouvement qui relève d’abord de ses militants, la prétention à se positionner comme « seul et unique représentant de la Kabylie », la tentation, par l’invective et l’intimidation, de rejeter dans le camp de la « trahison » ceux qui ont un point de vue différent, pose un problème de démocratie et de liberté. C’est la négation des valeurs portées par le Printemps berbère. Pour ceux d’entre nous qui sont restés attachés à ces valeurs, le MAK ne peut s’exonérer d’un débat impliquant nécessairement tous les concernés.
Ces mouvements sont-ils des produits de la revendication amazighe ? La renforcent-ils ou, au contraire, la mettent au second plan ou l’affaiblissent ?
Ils sont d’abord le produit du déni de citoyenneté et de la répression qui n’a pas toujours fait dans le détail. Les désillusions à l’égard de l’État-nation centralisé et autoritaire qui traque les libertés, nie les identités réelles, vécues, ressenties, au profit de fictions artificielles imposées par décret, ont fait le reste pour pousser des militants à prospecter de nouvelles voies pour sortir de l’impasse.
S’il est permis de ne pas partager leurs propositions et de les discuter, leur quête est, toutefois, méritoire et digne de respect. En fin de compte, c’est le débat démocratique qui permettra de clarifier les enjeux et d’éviter les dérives auxquelles poussent les cagoulards spécialisés dans les coups tordus.
Ceci dit, l’on ne peut qu’être surpris par les gloussements de vierges effarouchées qui éructent et crachent la haine contre ces mouvements qui sont – et on ne le rappellera jamais assez – pacifiques, alors que ces mêmes voix avaient justifié, et parfois applaudi, les crimes islamistes des années 90, en prêchant le dialogue et la réconciliation avec leurs auteurs.
Ce 20 avril, vous marcherez à Tizi-Ouzou ; ça sera dans le cortège du RCD ou dans celui du MAK ?
L’idéal serait d’organiser une manifestation unitaire, dans le respect des convictions de chacun, pour revisiter l’esprit du 20 avril. Par ces temps d’incertitudes du présent et d’inquiétudes pour l’avenir, l’esprit du 20 avril peut être un référent de ressourcement,pour définir de nouveaux objectifs, tracer de nouvelles perspectives, faire jonction avec d’autres mouvements démocratiques qui luttent sur le terrain,en Algérie et dans le sous-continent nord-africain, et ranimer ainsi l’espoir.
Pour l’instant, cette convergence n’est pas encore à l’ordre du jour.
Après le printemps amazigh, vous avez contribué à la création de la première Ligue algérienne des droits de l’Homme. Est-ce que ce combat pour les droits de l’Homme est une suite logique à la lutte identitaire ? Quel lien y a-t-il entre la lutte démocratique, la revendication amazighe et la question des droits de l’Homme ?
Les libertés démocratiques, le pluralisme (politique, culturel, syndical, religieux…), et les droits de l’Homme (et de la femme, faut-il le préciser) sont intimement liés. C’est un « package » dont les éléments sont indissociables. Il ne peut y avoir respect de la diversité sous un régime de dictature. De même que la violation des droits de l’Homme, dont la plus perverse reste l’usage de la torture, est incompatible avec la démocratie.
Nous avons vu comment le pouvoir avait répondu à la création de la Ligue des droits de l’Homme, en 1985, par la création d’une Ligue officielle toute à sa dévotion. À l’époque, on disait : « Les droits de l’Homme ne sont pas le monopole d’un courant politique » ! Nous connaissons la suite.
Que reste-t-il du 20 avril 1980 ? Selon vous, cette date devrait être célébrée ou commémorée ?
Au-delà de l’écume des célébrations et des commémorations qui renvoient au passé, le Printemps berbère c’est d’abord un désir d’avenir, un état d’esprit : l’esprit de résistance contre l’arbitraire et la capacité de réinventer l’espoir, même lorsque l’impasse paraît insurmontable.
C’est en revisitant l’esprit du 20 avril, loin des récupérations qui tentent de le confiner dans le folklore, et des manœuvres d’apparatchiks pour le domestiquer au service du pouvoir et de ses clientèles, que l’on pourra regarder l’avenir avec sérénité.