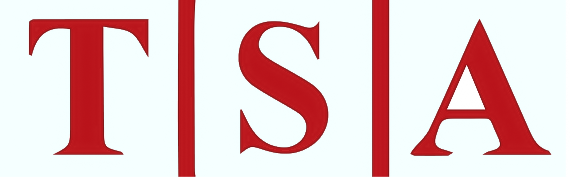Rachid Boudjera revient à l’écriture du pamphlet. Après « Fis de la haine », publié en France en 1992, dans lequel il critiquait l’ex-Front islamique du salut (FIS), le romancier publiera, dans les prochains jours, « Les contrebandiers de l’Histoire », aux éditions Frantz Fanon à Tizi Ouzou.
Dans ce livre d’une centaine de pages, le romancier fait le procès d’une certaine élite algérienne qui défend les « thèses néocoloniales », qui « falsifie l’Histoire » et qui exprime « la haine de soi ». Il critique, entre autres, Boualem Sansal, Kamel Daoud, Fériel Furon, Wassila Tamzali, Yasmina Khadra et Salim Bachi.
La parution en 2015 du livre « Si Bouaziz Bengana, dernier roi des Ziban » de Feriel Furon en France a été « le déclic » qui a amené Rachid Boudjedra à écrire le pamphlet pour « ne pas mourir de lâcheté ».
Arrière-petite-fille de Bachagha Bengana, caïd des services civiles français, Feriel Furon est passée sur Canal Algérie, le 21 février dernier, pour « faire la promotion » de son livre, ce qui a suscité une vive polémique en Algérie.
« Toute la tribu des Bengana fut « bachaghisée » par la France. Elle a collaboré férocement, de 1846 à 1962, avec une servitude inouïe et un zèle de prédateur sanguinaire, en faveur de la puissance coloniale. Et c’est à cet ancêtre, sadique et pervers, que Ferial Furon, son arrière-petite-fille, va rendre hommage, toute honte bue. Le pire est qu’elle sera invitée par l’IMA à Paris d’abord, en suite par le Centre culturel algérien dans la même ville. Puis par l’Algérie où elle donna une conférence à l’Institut français d’Alger. Elle fut, aussi, invitée à faire l’éloge de son aïeul dans une émission qui lui avait été consacrée par la chaîne de télévision publique Canal Algérie. Elle le décrivit comme « un aristocrate raffiné et un homme valeureux », alors qu’il n’avait été qu’un petit supplétif assoiffé de sang, zélé et cruel », écrit Rachid Boudjedra.
Le romancier a rappelé « les méthodes » de torture de Bachagha Bengana comme la mort par piqûre d’abeilles. Il s’est dit révolté par la publication du livre. « Le livre avait suscité une certaine sympathie, voire une certaine complicité dans certains médias et cercles du pouvoir, mais suscité aussi une indifférence générale dans le pays profond. Longtemps je me suis, donc, tu devant des falsifications de l’Histoire nationale chez quelques nostalgiques de la période coloniale. J’avais choisi le silence comme mode de mépris sidéral. Je côtoyais certains de ces contrebandiers de notre Histoire et de ces flibustiers du panache artificiel, mais je restais poli devant leurs exactions et leurs dérives, pensant que c’était leur droit d’exprimer leurs sentiments ou leurs ressentiments au nom du sacro-saint dogme de la « la liberté d’expression » », a-t-il développé.
Selon lui, l’élite, qui a quitté le pays durant les années 1990 vers l’Europe, a perdu « complètement ses repères, ses convictions et ses principes ». « Ces fuyards avaient honte de leur fuite et transformaient cet acte de lâcheté en acte de bravoure. L’inconscient, le non-dit, les difficultés matérielles, le déclassement professionnel étaient, souvent, leur lot. Des médecins de grande qualité et de haut niveau se voyaient rétrograder au rang de simples infirmiers », déplore-t-il.
« Une littérature du déni de soi »
Qualifiant Boualem Sansal de « contrebandier », Rachid Boudjedra rappelle que l’auteur de « L’Enfant fou de l’arbre creux » était un haut fonctionnaire qui « fréquenta d’une façon très zélée les cabinets ministériels » pendant 37 ans de fonction publique.
« Il restait indifférent, imperturbable et aveugle devant les différentes répressions que le pouvoir algérien, dont il était l’émanation éclatante, faisait subir à la société civile (…) Dans son premier livre, « Le serment des barbares », Boualem Sansal posait déjà ses pions pour installer, subrepticement et malicieusement, une littérature du déni de soi. C’était une sorte de critique politique, voire un genre de pamphlet. Bien d’autres écrivains algériens, bien avant lui, l’avaient déployée dans leurs romans, leurs films, leurs pièces de théâtre et même leurs tableaux de peinture. Cette production portait un regard critique non pas de la société mais du pouvoir, ce qui constituait une autocritique », analyse-t-il.
Pour lui, « Le serment des barbares » (paru en 1999) est « un roman de règlement de comptes » surfait, « un tract politique plutôt sympathique qui manquait d’épaisseur poétique ».
« Il flottait dans les romans de Boualem Sansal cette ineffable nostalgie de la France coloniale, où on vivait si bien, et ce sentiment de manque d’un monde à jamais disparu (…) Jusque-là, j’étais l’ami, un brin paternaliste de Boualem Sansal et ce jusqu’au jour où il publia « Le Village de l’Allemand » dont la thèse principale consistait à considérer l’Armée de libération nationale comme une armée nazie et dirigée par des officiers du IIIe Reich qui se seraient réfugiés en Algérie après la défaite de l’Allemagne en 1945. Que ses officiers étaient donc, et pour la plupart des officiers du IIIe Reich. Un tissu de mensonges aberrant, un « texte de contrebande » et une volonté de complaire à ceux qui, en France, n’ont jamais digéré la victoire militaire de l’ALN sur l’Armée Française », assène Boudjedra.
Poursuivant, il écrit : « Évidemment, Le Village de l’Allemand fut traduit en Israël, et Boualem Sansal invité dans ce pays qui le porta aux nues, au point que notre écrivain alla se recueillir sur le mur des lamentations ! Ce que les sionistes français et européens apprécièrent énormément, faisant de Boualem Sansal une icône de la grande littérature, une icône de la tolérance, une icône de l’humanisme, une icône… ».
Boudjedra cite cinq intellectuels français comme « promoteurs » des Algériens qui écrivent et éditent en France : Bernard-Henri Lévy (désigné comme « un agité du bocal »), Alain Finkielkraut, André Glucksmann, Pascal Bruckner et Éric Zemmour.
Présentés comme des islamophobes, ces cinq écrivains auraient, selon lui, trahi Jean Paul Sartre. Continuant sa charge contre Boualem Sansal, Rachid Boudjedra ajoute : « Boualem Sansal, l’homme du système algérien choyé en bureaucrate docile, et qui a profité d’avantages substantiels pour pouvoir construire une belle villa à Zemmouri El Bahri, près d’Alger, dans un site protégé et consacré au patrimoine touristique. Notre « opposant » notoire est allé jusqu’à faire profiter ses amis d’une telle aubaine en leur permettant de construire eux aussi de belles villas sur un site magnifique ».
« Confrérie camusienne »
Selon lui, « Ce que le jour doit à la nuit » de Yasmina Khadra est un roman qui « fait l’éloge de la cohabitation heureuse et enchanteresse entre les Français d’Algérie et les « Français musulmans » d’Algérie comme l’administration coloniale surnommait les Algériens. Il est l’expression d’un fantasme algérien que Frantz Fanon, encore lui, avait bien analysé. Le colonisé est souvent orphelin de son colon ; et de ce fait il va le sublimer, lui trouver toutes les qualités humaines et extrahumaines ».
Il reproche à Yasmina Khadra de n’avoir pas relaté les faits répressifs coloniaux. « Je considère que ce roman est une erreur de parcours ou un excès de naïveté mais qu’il n’enlève rien au grand écrivain qu’est Yasmina Khadra », tempère-t-il.
Rachid Boudjedra tire à boulets rouges sur les cinéastes algériens installés en Europe. « Il y a actuellement une nouvelle génération de cinéastes qui vivent à l’étranger et qui réalisent des films de mauvaise qualité esthétique, souvent coproduits par l’Algérie et dont le but est de rabaisser notre pays, non seulement politiquement mais humainement et psychologiquement. Avec une volonté de le saper, de le punir, aussi, d’avoir obtenu son indépendance. Je ne citerai parmi ces films, qu’un seul : El Wahrani, de Lyes Salem », détaille-t-il.
Wassila Tamzali n’échappe pas aussi à la foudre de Boudjedra qui la qualifie d’adepte de la théorie du « Qui tue qui ? » durant les années 1990. « Je n’aurais jamais évoqué ces péripéties pénibles et lamentables si Wassyla Tamzali n’avait pas commis ce roman (Une éducation algérienne) où elle disculpait son père abattu, donc, à Béjaïa, pendant la Guerre de libération sur ordre du Grand Amirouche, chef de la Wilaya III, à l’époque. Tout le roman « Une éducation algérienne » était un énorme déni de l’Histoire nationale si douloureuse et si effroyable de mon pays. Un objet non pas de propagande mais de contrebande où on falsifie ce maelström qu’a été la guerre d’Algérie», relève-t-il.
« Trahison permanente »
« Depuis longtemps, j’ai été hanté par cette trahison permanente d’une certaine élite algérienne qui a souvent la double nationalité, vit, très souvent, de l’autre côté de la mer et dont je n’ai jamais pu accepter, la conduite. En effet, l’inconscient du colonisé est un gouffre sans fond ! D’où ce chaos, ce maelstrom qui fait qu’un Algérien se prend en horreur, qu’il a la haine de soi – haine de soi qui est souvent en fait la haine de l’Autre, aussi –, au point qu’il se dégoûte de lui-même », assène encore Boudjedra.
Enchaînant, le romancier reproche à Kamel Daoud de faire l’éloge de Camus, « qui n’est pas algérien, mais français ». « Commettre un livre comme Meursault, contre-enquête – en plein centenaire de la naissance de Camus ! – c’est trafiquer l’Histoire. C’est pratiquer la contrebande intellectuelle. Ceci dit Kamel Daoud a le droit de faire la lecture de Camus qui lui convient. Ce qui m’a dérangé, c’est son comportement à la sortie de son livre, en France. Là il s’est comporté en larbin qu’on a vite récupéré. Et qui a déclaré dans l’émission ‘On n’est pas couché’ animée par Laurent Ruquier : « La Palestine n’est pas mon problème !(…) » Et immédiatement Kamel Daoud se vit offrir des chroniques dans des journaux prestigieux et très occidentaux : Le Point en France et Le New York Times aux USA ! Pourquoi, alors, une telle ascension vertigineuse ?! La réponse est évidente et cela s’appelle une récupération. Dommage ! Car j’ai connu, quant à moi, un Kamel Daoud plus fier et plus orgueilleux ».
Selon l’auteur de « L’insolation », Albert Camus s’est opposé à la lutte des Algériens contre le colonialisme français, ce qui n’empêche pas « une confrérie camusienne » qui « s’agite avec l’aide de l’ambassade de France » de le défendre. « Et c’est cette même confrérie qui comprend Kamel Daoud, Wassyla Tamzali, Mohamed Lakhdar Maougal, ainsi que certaines professeurs de français de l’Université d’Alger », énumère-t-il.
« Prédateurs anti-algériens »
« J’avais donc honte depuis très longtemps de laisser les prédateurs anti-algériens agir et réagir dans le déni, le mensonge et la fabrication d’une fausse Histoire Nationale. L’occupation coloniale avait été souvent enjolivée et le mythe du bonheur algérien fut inventé. Alors que la colonisation qui a commencé avec les Ottomans et s’est terminée avec les Français a été féroce et deshumanisante. Son horreur, sa cruauté et sa longévité ont été démesurées, démentes et incroyables », écrit-t-il.
Pour Boudjera, l’Histoire de l’Algérie a été « falsifiée, contrefaite et trafiquée tant par les puissances occupantes que par certains autochtones qui ont joué le rôle de collaborateurs zélés de l’ennemi et qui ont été ses complices dans le martyre du peuple algérien et cela pendant plus de cinq longs et interminables siècles ».
« Cette longue relation falsifiée de l’histoire coloniale et impériale du pays s’est perpétuée jusqu’à nos jours ; et j’ai été souvent intrigué par notre passivité à regarder les étrangers et certains de leurs acolytes autochtones se promener à leur guise dans cette histoire si mouvementée et si cruelle, sans bouger et sans réagir. Ou rarement ! », dénonce-t-il.
Il rappelle les travaux de Mohamed Sahli, Mostefa Lacheraf et Mohamed Harbi qui ont remis en cause « la falsification de l’Histoire algérienne par les anciens colonisateurs ».
L’écrivain cite deux exemples de production littéraire et artistique qui, selon lui, défendent « une vision néocoloniale et antinationale » : le roman « Le village des Asphodèles » de Ali Boumahdi (1970) et le film « Les folles années du twist » de Mahmoud Zemmouri (1982).
« Ces deux productions « artistiques » sont le point de départ d’une idéologie algérienne du déni, prônée par certains politicards et artistes algériens. Dans ce film dont les péripéties se déroulent dans la ville de Boufarik durant la guerre de libération qui n’existe pas du tout dans ledit film et où Pieds noirs et « Français musulmans » d’Algérie vivent en toute tranquillité, passent leur temps à forniquer entre eux, à boire et à… danser le twist, danse à la mode à cette époque. Ce film se voulait une comédie pétillante, désopilante et décontractée et prônait (presque !) l’amitié entre les peuples ! Entre le bourreau et sa victime, quoi », dénonce encore Boudjedra.
Pour l’auteur de « La vie à l’endroit », « Le parti de la France » existe bel et bien en Algérie. « Nous sommes assaillis par des articles de presse, des romans, des essais, des films et autres productions idéologiques qui tracent le même parcours du déni, du mensonge et de la fabrication gommant la réalité historique intrinsèque et affirmant non seulement leurs regrets amers de n’être plus « les enfants de la patrie française », mais aussi leur terrible nostalgie et leur malheur inconsolable de n’être plus que des citoyens algériens », développe-t-il. Il évoque aussi « le complexe de l’esclave qui refuse d’être libéré par son maître ».