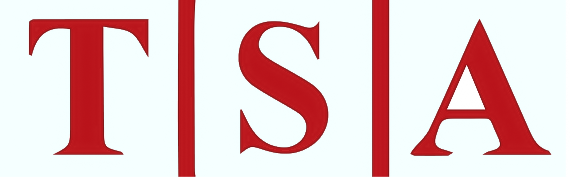« Quand je ne pouvais plus tenir sur mes jambes, ma mère me prenait sur son dos. Nous avons marché pendant vingt jours dans le désert pour arriver jusqu’ici. » Fatima Abdallah, la cinquantaine passée, est deux fois grand-mère.
Quand sa famille avait quitté la région de Dakhla, sur la côte atlantique du Sahara occidental, pour trouver refuge dans un camp près de Tindouf en Algérie, elle avait à peine sept ans.
Comme elle, ils étaient des dizaines de milliers de Sahraouis à fuir le territoire envahi au milieu des années 1970. Ils se sont installés dans des camps de réfugiés dans le sud-ouest algérien. 45 ans après, ils y sont toujours, avec leur descendance.
C’est la plus longue situation d’exil dans le monde, décrit le Haut-commissariat des Nations-Unies aux réfugiés (HCR). Aujourd’hui, ils sont plus de 173 000 (chiffre d’une étude inter-agence effectuée en 2018), répartis sur quatre grands camps ayant le statut de wilaya, représentant celles du Sahara occidental : Laâyoune, Aousserd, Smara et Dakhla. Les camps sont administrés par les autorités de la République sahraouie (RASD).
Fatima habite celui d’Aousserd. Elle ne se souvient pas trop de ce que fut sa vie et celle de sa famille avant la guerre, mais elle se rappelle très bien du « voyage » et de ses premières années dans le camp. « Chaque famille était installée dans une tente. Il n’y avait rien. On dépendait entièrement de l’aide humanitaire », dit-elle.
Lentement certes, mais les choses ont changé au fil des années. Les tentes de toiles sont presque invisibles. Du moins dans le camp d’Aousserd, les constructions sont pour la plupart en dur. Les gens se sont mis à construire en briques d’argile, puis, dans les années 2000-2010, en parpaing. Comme s’ils avaient fini par comprendre que leur exil ne sera pas de courte durée.
Les toitures sont en dalle de béton, parfois en tôle. L’intérieur est généralement composé d’une grande pièce, et d’une ou deux autres moins spacieuses. Chaque maison dispose d’une courette clôturée. Les anciennes constructions en terre sont converties en sanitaires.
| Lire aussi : Sahara occidental : Ghali critique l’ONU et tend la main pour une « paix juste »

Crédit photo : TSA.
« Un camp de réfugiés reste un camp de réfugiés »
Ce n’est pas la belle vie, mais certaines commodités ont fait leur entrée progressivement. La route principale qui mène aux camps est rectiligne et fraîchement goudronnée. L’électricité est acheminée à partir de Tindouf, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest. Tous les foyers sont raccordés et la redevance n’est pas ruineuse : un forfait de 250 DA par trimestre, nous apprend-on.
Les ménagères disposent de l’essentiel, en tout cas d’un réfrigérateur et d’une cuisinière. Dans cette région où les températures passent d’un extrême à l’autre dans la même journée, certains foyers sont aussi dotés d’un climatiseur. Et d’un téléviseur plasma. Les antennes paraboliques sont encastrées à même le sol dans les courettes. Un pied de nez au vent qui souffle fort et sans préavis.
La téléphonie mobile et la connexion internet sont assurées par le réseau de l’opérateur algérien Mobilis. Les boutiques, de minuscules bâtisses carrées, assurent la disponibilité des produits et des services, comme l’indiquent les enseignes peintes à la va-vite : boulangerie, coiffeur, pièces détachées, casse automobile, téléphonie, alimentation, boucherie… Certaines sont même bien achalandées.
« Nous nous approvisionnons à Tindouf, dans d’autres villes d’Algérie et même en Mauritanie », explique Mahfoud, vendeur de téléphones portables. Son petit magasin ne diffère pas trop de ceux des villes algériennes.

Crédit photo : TSA.
Sur les étagères en verre, des téléphones de toutes les marques, des accessoires, des lunettes de soleil. Même le fameux chèche saharien est proposé. Les prix sont plutôt abordables. La monnaie la plus utilisée, c’est le dinar algérien, il faut juste se mettre à compter comme les autochtones. La règle est simple : multiplier le prix local par cinq. Un paquet de cigarettes coûte « 60 », donc 300 DA.
L’eau, en revanche, continue à constituer un casse-tête. Des camions citernes remplissent des bâches de quatre à six mètres carrés, disposées devant les maisons. « On se débrouille comme on peut pour l’eau. Notre problème le plus urgent c’est l’assainissement. Les fosses septiques individuelles s’avèrent souvent insuffisantes et incommodent les habitants par les odeurs nauséabondes qu’elles dégagent », nous dit El Ouali, la trentaine, un employé gouvernemental. « Nos conditions se sont améliorées un peu mais un camp de réfugiés reste un camp de réfugiés. On ne peut pas tout avoir », ajoute-t-il.
L’autre relent qui n’échappe pas aux narines, c’est celui des « écuries » improvisées dans les larges espaces entre les habitations. Dans de petits enclos aux formes sommaires et grossièrement clôturés, vivotent, brûlent sous le soleil de la journée et grelottent de froid la nuit, chèvres, brebis et quelques dromadaires. Une brebis et son petit s’acharnent avec leurs dents sur un objet circulaire qui sort de terre. Peut-être une roche ou le vestige d’une ancienne habitation.
Peu probable que ce soit le reste d’un tronc d’arbre mort. Ici, il n’y a pas de végétation. Pas un seul arbre ou brin d’herbe sur des kilomètres à la ronde. Le désert prend tout son sens. Des étendues immenses de sable, jonchées de gros cailloux noirâtres. « C’est du minerai de fer à ciel ouvert », nous explique-t-on. La mine de Gara Djebilet, un des plus grands gisements de fer au monde, est à quelques dizaines de kilomètres plus au sud.
| Lire aussi : Sahara occidental : l’administration Biden n’a pas encore tranché

Crédit photo : TSA.
« Nous n’oublierons pas tout ce que l’Algérie a fait pour nous »
Dans les rues déformées et poussiéreuses circulent sans discontinuer des 4×4 et des Mercedes. Dans cet univers de privations, le véhicule ne semble pas être un luxe. Les Sahraouis circulent presque tous en Mercedes.
« On les ramène d’Espagne via le Maroc ou la Mauritanie. Ce sont de vieux véhicules, pas trop chers, mais en bon état », explique M’hamed, un jeune à peine sorti de l’adolescence. Sa Mercedes 220, année 1994, lui a coûté quelque chose comme 35 millions de centimes. C’est plutôt bon marché. Le carburant est légèrement plus coté qu’en Algérie. Un litre d’essence est cédé à 50 DA par les revendeurs. Ici, il n’y a pas de stations-service.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les enfants des camps ne sont pas privés d’école. Elle est même obligatoire. Il y a un établissement primaire dans chaque daïra et un collège dans chaque wilaya. Pour le lycée et la Fac, il faut aller en Algérie.
« Nous n’oublierons jamais tout ce que l’Algérie a fait pour nous. Elle a fait plus que son devoir, plus qu’il n’en faut », reconnaît la fille de Fatima, Meriem, la trentaine. La jeune femme, mère de deux enfants, a fait des études de lettres arabes à l’université de Khemis-Miliana avant de rentrer dans le camp et enseigner dans un collège. Un métier qu’elle a dû abandonner pour des raisons familiales et de santé.
Comme beaucoup d’habitants des camps de réfugiés, elle est asthmatique. En cause, les vents de sable fréquents. Comme pour l’enseignement, les autorités sahraouies ont mis en place une carte sanitaire : un hôpital national à Rabouni, siège de la présidence sahraouie, un autre dans chaque wilaya et un dispensaire par daïra. Pour les cas compliqués, c’est encore en Algérie qu’ils sont évacués.

Crédit photo : TSA.
Un peuple digne et déterminé
Les Sahraouis survivent et vivent comme ils peuvent, mais ils n’oublient pas un instant qu’ils sont en guerre et que leur objectif ultime est de libérer leur pays de l’occupation marocaine et d’y retourner.
Au moment où Meriem et sa mère racontent les vicissitudes de la vie quotidienne, leurs maris respectifs sont de l’autre côté de la frontière, dans les territoires sahraouis libérés. Ce sont des militaires. Le mari de Fatima n’est pas loin de la soixantaine et est au front depuis les années 1980.
« Il a des blessures sur tout le corps », témoigne sa femme. Lui et son fils viennent passer cinq jours chez eux tous les deux mois. Leurs soldes suffisent à peine pour faire vivre la famille de quatre membres, mais les deux femmes ne s’en plaignent pas. D’autres n’ont rien et dépendent entièrement des aides humanitaires. Et puis, presque toutes les familles des camps sont dans la même situation. Les hommes partent au front dès qu’ils sont en âge de manier une arme.
« Ils le font volontairement », assure El Ouali, l’employé gouvernemental, lui-même un militaire. Dans les camps, ce sont les femmes qui s’occupent de tout, avec les rares hommes qui n’ont pas rejoint l’armée et qui font marcher les petits commerces.
La libération du pays est la cause de tous. Sur toutes les maisons, flotte l’emblème vert, blanc, rouge et noir de la RASD. « C’est aussi une initiative des habitants. Personne ne les oblige à le faire », affirme El Ouali.
Ce prénom est l’un des plus répandus dans les camps, en hommage à l’un des pères fondateurs du front Polisario et de la RASD, El Ouali Mustapha El Sayed, mort au combat en 1976 en Mauritanie au moment où ce pays occupait une partie des territoires sahraouis après le retrait des troupes espagnoles.
Les habitants peuvent raconter les moindres détails de toutes les péripéties de cette période et de tout le conflit : l’invasion marocaine, le retrait mauritanien, le cessez-le-feu de 1991, le mandat de la Minurso, les positions des différentes puissances mondiales, de dernier deal triangulaire entre le Maroc, les États-Unis et Israël. Ils connaissent aussi l’histoire de tous les pères fondateurs. Parmi eux, l’actuel président de la RASD, Brahim Ghali, un mythe vivant.
« Il devait être élu président en 1976. C’est lui qui avait refusé, préférant poursuivre le combat sur le terrain. Il a dirigé de nombreuses batailles, il avait été emprisonné par les Espagnols déjà », croit savoir Fatima.
La mobilisation pour l’objectif commun frise l’unanimité, même si des voix discordantes se font parfois entendre. « Oui, il y a des mécontents, mais ils sont une infime minorité. Ils doivent comprendre que ce n’est pas le moment d’étaler nos divergences », concède Meriem.
Dans la matinée même, non loin de la maison des deux femmes, se tenaient les cérémonies célébrant le 45e anniversaire de la création de la RASD. Et un de ces « mécontents » a tenté de jouer les trouble-fêtes en insultant les gendarmes chargés d’encadrer la foule. Il est vite maîtrisé et embarqué sans que presque personne ne s’en rende compte. Ses vociférations sont étouffées par les chants de la foule en liesse.