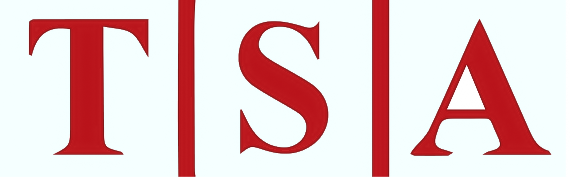ENTRETIEN. Azzeddine Mihoubi, ministre de la Culture, parle dans cet entretien, du financement des festivals, de l’austérité, des nouvelles mesures pour les subventions destinées à la production de films, du projet du film sur l’Émir Abdelkader, des salles de cinémas…
Il n’existe pas de rentrée littéraire en Algérie. Pourquoi ?
Ce n’est pas au ministère de la Culture d’assurer la rentrée littéraire. C’est l’affaire des éditeurs. Le Salon international du livre d’Alger (Sila), qui se tient fin octobre, représente symboliquement la rentrée littéraire. C’est là où l’on découvre les nouvelles publications. Nous avons réfléchi à une grande manifestation dédiée, en dehors du Sila, à présenter et exposer les nouvelles parutions avec l’organisation de conférences et des hommages.
Le prochain Sila, plus grand événement culturel du pays, est prévu du 26 octobre au 4 novembre 2017. Quel est le pays invité d’honneur cette année, après l’Égypte en 2016 ?
Nous n’avons pas encore tranché. Toujours est-il que nous nous orientons de plus en plus vers l’Afrique, notre espace culturel. Récemment, l’Algérie a participé à la manifestation « Conakry, capitale du livre » en Guinée. L’Algérie sera aussi présente dans des festivals africains de danse contemporaine et de musique symphonique. Nous voulons que l’Afrique soit présente dans les événements culturels que l’Algérie organise. En ce sens, nous réfléchissons à la création d’un festival cinématographique africain dans une ville du sud algérien.
Beaucoup d’éditeurs algériens veulent exporter le livre algérien vers l’Afrique. Comment pouvez-vous les aider ?
Nous espérons exporter le livre algérien vers l’étranger, pas uniquement vers l’Afrique pour faire connaître notre production intellectuelle. Mais, c’est d’abord une opération commerciale qui implique l’existence d’entreprises spécialisées dans le domaine. Il est nécessaire d’avoir des distributeurs et des éditeurs qui ont des contacts avec leurs homologues en Afrique, dans la région méditerranéenne et dans le monde arabe. L’initiative doit donc venir d’abord des éditeurs pour améliorer le climat de distribution en Algérie et trouver des canaux à l’étranger. Le ministère de la Culture s’engage à les accompagner. Nous attendons donc des propositions concrètes des éditeurs. À eux de préciser ce qu’ils veulent de nous en tant que pouvoirs publics pour soutenir la distribution des livres à l’étranger. Nous pouvons intervenir par exemple pour avoir des facilités fiscales ou une aide pour le transport.
Le prix Assia Djebbar du meilleur roman sera-t-il maintenu cette année ?
Nous avions dès le départ bien accueilli la création d’un prix littéraire au nom d’une romancière algérienne de stature internationale. Le projet a été proposé avant mon arrivée au ministère. Dès le départ, l’idée était que le prix soit organisé et financé par deux grandes entreprises publiques d’édition (Enag et Anep). Il y a eu deux éditions. Lors de l’édition 2016, l’Enag a senti qu’elle a été écartée dans l’organisation et dans le choix des membres du jury. Nous devons maintenir l’organisation annuelle de ce prix destiné aux romanciers écrivant dans les trois langues (tamazight, arabe et français).
Il est également question de créer un autre prix littéraire…
C’est un prix que l’État veut lancer pour honorer les écrivains qui ont marqué la scène littéraire. Ce prix est différent des médailles de mérite national. Un comité sera créé pour choisir les auteurs qui méritent d’être portés sur une liste de quatre prix. Des prix dotés d’une somme conséquente à la hauteur de la valeur des lauréats. Un projet de décret est à l’étude pour concrétiser ce projet.
Par ailleurs, nous sommes disposés à soutenir l’association culturelle Nawafidh pour le lancement du prix Tahar Ouettar du meilleur roman. Nous avons déjà soutenu les prix Moufdi Zakaria et Mohamed Dib. Moralement, nous sommes tenus d’appuyer les prix qui portent des noms de grands auteurs de la littérature et de la culture algériennes. Le roman algérien occupe aujourd’hui les premières places dans le monde arabe. Les auteurs algériens ont raflé ces dernières années les meilleurs prix littéraires. Ahlem Mosteghanemi et Waciny Laredj sont des stars dans les pays arabes. Nous voulons relancer le Festival Mohamed Laid Khalifa de la poésie à Biskra et reprendre le Festival Réda Houhou de la nouvelle à Saida.
Le ministère de la Culture est là pour soutenir les associations et les fondations qui prennent des initiatives culturelles. Ce n’est pas au ministère d’organiser ces événements ou d’en avoir la tutelle.
Pourquoi la littérature algérienne est peu traduite dans les autres langues ?
La traduction est une opération coûteuse. En Algérie, nous avons peu de traducteurs littéraires contrairement aux traducteurs techniques. J’ai appelé à plusieurs reprises à la création d’une Association des traducteurs littéraires en vue de les rassembler et pour fixer les critères professionnels. Nous trouvons aujourd’hui des travaux mal traduits. Certains ont recouru à Google translate ou à la traduction mécanique qui dénature les textes. La traduction est un art, une seconde écriture. Le traducteur est d’abord un bon lecteur. Certaines traductions ont dépassé en qualité les textes originaux. Les écrivains Merzak Begtache, Djillali Sari et Djillali Khelas ont fourni beaucoup d’efforts pour traduire des textes.
Récemment, l’Institut supérieur arabe de traduction dont le siège est à Alger a été sollicité pour prendre en charge des textes. Tout le mérite revient à la directrice Inaâm Bayoud qui œuvre pour faire émerger une nouvelle génération de traducteurs littéraires.
Aujourd’hui, traduire du français vers l’arabe est plus courant que le mouvement contraire (de l’arabe vers le français), faute de traducteurs. Nous avons aussi des difficultés pour la traduction de tamazight vers les autres langues.
Faut-il que l’université s’implique davantage ?
Oui, nous voulons que les instituts de langues et d’interprétariat dans les universités apportent leur contribution en travaillant avec les maisons d’édition. Notre but est de faire traduire les œuvres littéraires algériennes dans plusieurs langues, y compris les variantes de tamazight. Ahlem Mostaghnemi a, par exemple, appelé à traduire ses livres en chaoui. À Ghardaia, des jeunes ont traduit des poèmes de Moufdi Zakaria en mozabite. Il y a donc des initiatives mais nous n’avons pas un climat qui encourage le mouvement de traduction. Les éditeurs ne font pas beaucoup d’efforts en ce sens.
Des auteurs des pays arabes du Golfe m’ont demandé s’il était possible de faire traduire en français en Algérie leurs œuvres. Ils m’ont dit que l’Algérie qui a produit Kateb Yacine et Mohammed Dib peut assurer la traduction en français des livres édités dans leurs pays.
Vous avez parlé d’une nouvelle cartographie pour les festivals. Comment évolue l’opération ?
Seulement 10% des 176 festivals ont été maintenus. Les gens n’ont pas senti le changement puisque l’impact était faible. Nous avons établi une nouvelle carte des festivals en prenant en compte l’utilité culturelle. Nous voulons maintenir les principaux festivals dans toutes les formes artistiques (musique, cinéma, théâtre, danse, littérature, art pictural). Des festivals qui seront financés avec ce que nous avons comme capacités. Nous n’avons plus les moyens financiers d’il y a quatre ou cinq ans. Le budget destiné aux activités culturelles a été réduit. Le secteur de la culture subit la réduction du budget comme les autres secteurs, à part l’éducation et la santé. Ce n’est pas à l’État de produire la culture. Si c’est l’État qui produit la culture, il faut accepter alors la qualité de ce qui est proposé. L’État doit créer les bonnes conditions pour la production culturelle que la société doit assurer.
L’État a construit durant les vingt dernières années ce qu’il n’a pas fait pendant cinquante ans en termes d’infrastructures pour la culture. Il y a aujourd’hui des maisons de culture, des théâtres et de grandes salles. Le défi est de bien exploiter ces espaces au lieu de continuer de construire ou de reconstruire.
L’État cesse donc de construire des infrastructures culturelles…
Nous avons atteint le stade de la saturation. La salle Ahmed Bey de Constantine, l’une des plus importantes du pays, doit être, par exemple, bien exploitée. L’État a dépensé des millions de dinars pour que cette salle ait une utilité culturelle. Des salles de cinéma ont été réhabilitées mais pas mises en exploitation. Ces salles relèvent des APC, pas du secteur de la culture. Les APC doivent céder les salles en application de la Loi sur le cinéma de 2013. Il ne sert à rien de les garder fermées. Certaines mairies ne gèrent pas ces salles et ne veulent pas que d’autres les gèrent ! Lorsque le secteur de la culture prend en charge une salle de cinéma, il ne va pas la déplacer ailleurs. Elle sera mise à la disposition de la population locale et fera travailler les gens de la même commune.
Autre chose : les APC ne peuvent pas acheter des films de Hollywood ou de Bollywood pour les projeter dans leurs salles. L’ONCI (Office national de culture et d’information) négocie aujourd’hui avec des distributeurs internationaux pour projeter des films récents chez nous. Les salles relevant du répertoire de la cinémathèque algérienne seront ouvertes à l’exploitation commerciale avec la projection de longs métrages récents. Parallèlement, la cinémathèque continuera d’assurer ses missions habituelles.
Le gouvernement entend accorder des facilités aux personnes qui veulent investir dans le secteur du cinéma comme la construction de studios et de laboratoires, etc. Tout cela sera précisé après la présentation du plan d’action du gouvernement (au Parlement) à travers des décrets et des instructions.
Parlez-nous du projet de construire des multiplex en Algérie ?
Nous privilégions la construction des multiplex, c’est vrai. La première expérience sera à Annaba avec la transformation de la salle El Manar en multiplex. L’ARPC (Agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture) est chargée de suivre l’opération. Les multiplex donnent la possibilité d’avoir un choix varié de films pour tous les publics. Nous allons transformer les salles dont la surface permet d’en faire des multiplex. À Alger, des problèmes techniques ont empêché l’ouverture d’un multiplex au centre commercial de Bab Ezzouar. L’exploitant du centre n’a pas prévu au début l’ouverture d’un multiplex. Il y a actuellement des réserves techniques sur les normes de sécurité. Je conseille certains distributeurs privés de films de construire des multiplex en Algérie.
Certains films sont toujours en projet comme le biopic sur Ahmed Bey. À quand le début de tournage ?
Ce film a été inscrit dans le cadre de la manifestation, « Constantine, capitale de la culture arabe 2015 » qui a bénéficié d’une partie du budget et sera soutenu par l’ONDA (Office national des droits d’auteurs). La productrice (Samira Hadjdilani) a sollicité une équipe artistique et technique iranienne qui a déjà visité Boussaâda et Zaouia El Hamel où se déroulera une grande partie du tournage. Nous pensons à utiliser une partie des décors et des costumes du film d’Ahmed Bey pour le long métrage sur l’Émir Abdelkader puisqu’il s’agit de la même période historique. L’Iran est un pays leader en matière de production cinématographique. Les Iraniens ont une méthode efficace pour réduire les coûts de production et veillent toujours à terminer le tournage dans les délais pour éviter les surcoûts. Ahmed Bey ne sera pas une coproduction algéro-iranienne, ça sera un film algérien. J’avoue qu’il existe une difficulté pour financer ce film mais nous allons continuer à le soutenir avec une formule de financement graduel, ça sera une expérience différente.
Le film « Ben M’hidi » de Bachir Derrais sera-t-il prêt avant la fin de l’année en cours ?
J’ai vu le pré-montage du film et constaté qu’un effort a été fait. Il y a une volonté de réaliser un film réussi sur la personnalité de Ben M’hidi. Le réalisateur se dit optimiste et promet que son long métrage sera un grand film. Nous le soutenons pour qu’il le termine le plus rapidement possible. Le ministère des Moudjahidine a apporté également son appui pour que le réalisateur achève le long métrage. Nous attendons qu’il nous fixe la date de livraison de la version finale du film. Il n’a pas encore achevé la postproduction. Selon une première évaluation, « Ben M’hidi » a coûté 70 milliards de centimes. Les décors construits en Tunisie ont consommé presque 25% du budget du film.
Le projet du film sur l’Émir Abdelkader, le fondateur de l’État algérien moderne, a donné lieu à beaucoup de commentaires et d’interrogations. Ce projet a-t-il avancé ?
Je ne veux pas que le film sur l’Émir Abdelkader devienne un feuilleton mexicain. Une partie des décors et des costumes a été réalisée mais il y a un problème au niveau de la gestion. Nous avons reçu trois scénarios sur l’Émir Abdelkader. Le premier scénario a été écrit par Boualem Bessaieh en 2011, le deuxième est l’œuvre de Zaïm Khenchelaoui et de Philippe Diaz en 2013. Il y a enfin le scénario de Malek Aggoun en 2015. Ces scénarios traitent de la vie de l’Émir Abdelkader à partir d’angles différents. Nous devons trouver un scénario consensuel et cohérent car il s’agit d’un film qui raconte l’histoire d’une personnalité de stature mondiale. Aucune marge d’erreur n’est autorisée dans ce genre de film. Au début, on s’est trop précipité en sollicitant des techniciens étrangers et en signant des contrats avec eux sans faire attention au budget. De l’argent a été dépensé pour rien. Le budget initial du film était de 200 milliards de centimes. 150 milliards de centime ont été consommés dans l’achat d’accessoires et de costumes et dans le payement des salaires. Les décors et les costumes sont au niveau d’El Achour sous la responsabilité du CADC (Centre algérien du développement du cinéma). Le terrain a été préparé pour le film mais la première équipe de réalisation n’existe plus. Et nous n’avons pris aucune décision sur la reprise du film. Il faut d’abord qu’on étudie la situation financière. Les moyens actuels ne permettent pas la relance du projet du film sauf si on trouve un producteur algérien capable de participer au financement. Nous ne refusons pas un partenaire étranger à condition qu’il adhère à notre vision sur l’Histoire et sur la personnalité de l’Émir Abdelkader.
La gestion du Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographique (FDATIC) a-t-elle changé ?
Pour nous, l’argent du FDATIC doit aller prioritairement aux jeunes cinéastes qui produisent des films à coût réduit. Nous avons par exemple réuni une vingtaine de podcasters avec un cinéaste pour réaliser un long métrage à partir d’une écriture collective. C’est une histoire qui se passe dans le sud du pays. Il y a de l’aventure dans un esprit jeune. Il est temps qu’une nouvelle génération émerge dans le cinéma avec une nouvelle vision.
Certains cinéastes disent que l’État a abandonné le financement du cinéma…
Parce qu’ils se sont habitués à ce que l’État finance à 100% leurs films. Le 100%, c’est fini ! Nous allons dorénavant appliquer ce qui se fait ailleurs dans le monde en exigeant des cinéastes de présenter ce qu’ils ont comme financement avant d’étudier leurs dossiers de demande d’aide. Le problème est que les cinéastes ne ramènent rien et prennent la subvention de l’État, après ils proclament : « C’est mon film » ! Ils ne veulent même pas reconnaître que c’est l’État qui est producteur. Pire, ils disparaissent ensuite, sans présenter leurs films en Algérie, se contentent parfois de les proposer à des festivals. Aucun de ces cinéastes n’a présenté de bilan. Nous allons changer les conditions d’obtention de la subvention et demander des comptes à ces cinéastes. Par ailleurs, nous envisageons de récupérer les droits des films algériens, produits depuis l’indépendance du pays, et qui sont à l’étranger. Il y a des films algériens qui sont toujours projetés en dehors du pays sans que leurs droits ne soient versés à l’Algérie. Le CADC et le CNCA (Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel) ont été chargés d’élaborer une liste de tous les films dont les droits n’ont pas été recouverts avec l’aide de cinéastes tels qu’Ahmed Rachedi et Mohamed Lakhdar Hamina.
Revenons aux festivals. Le Festival international du théâtre de Béjaia est-il maintenu cette année ?
J’ai demandé le report de cette édition à 2018. Mais, le commissaire sortant du festival (Omar Fetmouche) a demandé, en coordination avec son successeur et la direction en charge du théâtre au ministère, d’organiser une édition spéciale cette année. Il a expliqué qu’il a pu avoir des sponsors. Donc, nous n’avons pas de raison de refuser. Nous soutenons ceux qui réussissent à avoir des moyens pour organiser des manifestations. Pour le festival d’Annaba du film méditerranéen, la période de son organisation nous a posé problème (en décembre 2015, puis en octobre 2016). Le commissaire (Said Ould Khelifa) a estimé que le printemps est la meilleure période pour organiser le festival. Nous sommes d’accord. Le festival aura lieu donc en mars 2018. Par ailleurs, nous n’avons pas encore ouvert le dossier du Festival national du théâtre professionnel (FNTP) avec le directeur du Théâtre national algérien (TNA). Il y a encore de la possibilité d’organiser la manifestation avant la fin de l’année. Désormais, nous abordons les festivals, calculatrice en main. Nous disons aux organisateurs de chercher des sources de financement supplémentaires à travers le sponsoring. Il faut qu’ils apprennent à frapper aux portes. Nous ne pouvons plus assurer le financement des festivals en milliards de centimes. C’est fini. Autre chose : il faut sortir de la culture du gratuit et habituer graduellement le public à payer pour voir un spectacle, un film ou une pièce de théâtre. J’appelle aussi les collectivités locales à contribuer au soutien financier des festivals.
Vous avez décidé de suspendre le Festival des arts de l’Ahaggar de Tamanrasset. Le festival sera-t-il relancé ?
Nous avons demandé au nouveau directeur de la culture de Tamanrasset de nous présenter une autre vision pour relancer ce festival. Des réserves ont été exprimées sur la méthode d’organisation et sur le contenu des précédentes éditions du festival. Un contenu qui ne reflétait pas les besoins culturels de la région. Nous voulons que le patrimoine de la région de l’Ahaggar soit mis en valeur dans ce festival.
Qu’en est-il du Dimajazz, Festival international du jazz de Constantine ?
Le comité d’organisation doit nous montrer les moyens financiers qu’il a pour le festival. Il faut qu’il paye les dettes et assainit le bilan comptable. L’ONCI demande à ce que la location de la salle (Ahmed Bey) soit payée, par exemple. Le Dimajazz est parmi les festivals qui ont réussi en Algérie mais nous voulons qu’il soit transparent dans sa gestion. Je pense que le comité va pouvoir l’organiser cette année. Il s’agit d’un événement culturel qui attire beaucoup de jeunes. Les organisateurs doivent faire montre d’un certain degré de professionnalisme dans la gestion. Ils ont dit que le festival a réalisé de bons résultats financiers. Où est cet argent ? Cela dit, je les encourage à organiser le festival.
Des artistes disent parfois qu’ils sont marginalisés, peu considérés. Vous en pensez quoi ?
Je veux qu’on m’explique le sens du mot « marginalisation ». L’artiste fait en principe un métier libéral. Il ne doit pas accepter de tutelle. L’État assure la couverture sociale pour les artistes. Le ministère du Travail a élaboré des textes en ce sens. Les artistes qui ont une carte (délivrée par le Centre national des arts et des lettres) peuvent bénéficier d’avantages sociaux. Aujourd’hui, 6.500 artistes ont obtenu cette carte. Le nombre d’adhérents à l’ONDA est de 19.000 qui peuvent avoir leurs droits selon leur activité annuelle. Lorsqu’un chanteur ou un musicien n’est pas sollicité pour un concert, il dit qu’il est marginalisé. Il y a des milliers d’artistes, peut-on les appeler tous ? L’ONCI fait, chaque année, l’effort d’inviter plusieurs artistes en essayant de donner la chance à tout le monde. De plus, il y a des artistes qui sont demandés par le public, d’autres non. Nous ne pouvons pas faire du social dans ce domaine. Un artiste doit s’imposer par son travail et par son talent. L’ONDA a toujours aidé les artistes algériens, même ceux qui tombent malades à l’étranger…